L’or de Venise
14 fragments d’un polyptyque attribué à Paolo
Veneziano et son atelier (XIVe siècle) aux musées de Poitiers
|
|
En 1851, M. Mauduyt acheta
pour le compte du musée municipal de Poitiers dont il était
conservateur, quatorze petits panneaux peints et dorés. Décrits par
Pierre-Amédée Brouillet, son successeur, comme des « débris
d’un retable italo-byzantin » dans le catalogue des collections
publié en 1884, ils étaient alors montés de manière factice dans
deux cadres : |
|
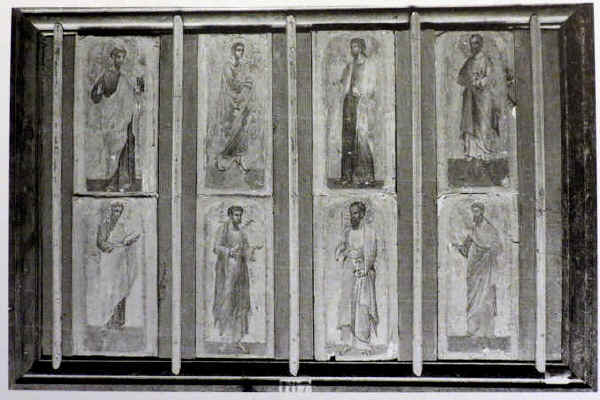
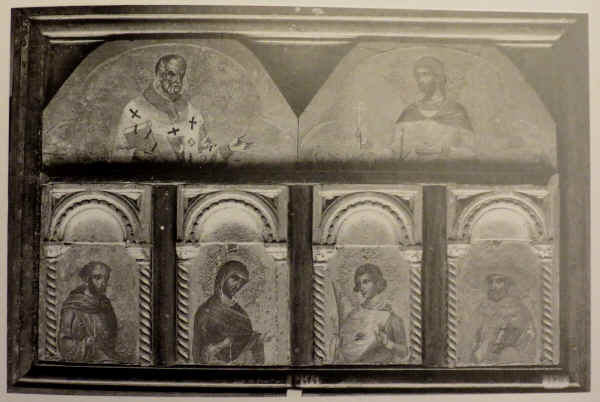
|
Dans l’un figuraient huit
saints en pied,
Dans l’autre deux saints
en buste sur des fonds d’or trilobés et quatre autres encadrés de
colonnettes torsadées.
La provenance de ces
fragments nous est inconnue. De toute évidence, ils constituaient des
parties latérales d’un polyptyque, probablement démembré à la fin
du XVIIIe ou dans la première moitié du XIXe siècle, à une époque où
de nombreuses œuvres du Trecento
connaissaient un sort semblable. L’intérêt, récent et limité, des
amateurs d’art, pour ces œuvres antérieures à la Renaissance,
suscitait de tels démantèlements de retables.
La redécouverte des
peintres vénitiens du XIVe siècle, amorcée au Siècle des Lumières
et modestement poursuivie au siècle suivant, s’épanouit réellement
au début du XXe siècle. Raimond Van Marle, en 1924, fut le premier
historien de l’art à intégrer les panneaux de Poitiers dans le
corpus des œuvres de l’école de Paolo Veneziano. Après lui, on les
attribua tantôt au maître lui-même, tantôt à son entourage.
La restauration de
l’ensemble, menée à partir de 1999 au Centre de recherche et de
restauration des musées de France à Versailles par Cinzia Pasquali, précédée
par des analyses radiographiques, a confirmé la qualité de l’exécution,
et débarrassé les panneaux des repeints anciens qui masquaient
notamment les lacunes provoquées par le démembrement du polyptyque.
L’exposition Autour
de Lorenzo Veneziano – Fragments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle,
organisée par le musée des Beaux-arts de Tours en 2005, a remis en
lumière ces quatorze fragments qu’Andrea De Marchi, spécialiste de
la peinture du Trecento et commissaire de
l’exposition, attribue à un proche collaborateur de Paolo placé sous
sa surveillance attentive, au sein de l’atelier, dans les années
1340-1345.
|
|
L’art de Paolo se définit
entre deux influences primordiales, celle de la peinture byzantine
d’une part, et celle de Giotto d’autre part, dont les fresques de la
chapelle de l’Arena, à Padoue, exécutées entre 1303 et 1305, ont
engagé les peintres du Trecento dans une révolution esthétique
capitale. Paolo Veneziano confronte cette recherche d’imitation
tridimensionnelle et d’illusionnisme structurel aux subtilités linéaristes
et chromatiques de la renaissance de l’époque paléologue, connues
notamment par les icônes portatives que les commerçants vénitiens
rapportent de Constantinople et des Balkans.
Dans cette inspiration dualiste, Paolo élabore un langage formel et
technique propre, reproductible par son atelier d’où sortent de
nombreuses œuvres. Si les traces autographes sont parfois difficiles à
identifier, le maître exerce néanmoins un contrôle permanent sur les
panneaux exécutés, car il demeure responsable de la qualité devant le
commanditaire.
Le système d’ornementation des auréoles adopté dans l’atelier de
Paolo constitue un des éléments d’identification de sa production :
à l’intérieur d’un double trait de contour, incisé dans le fond
d’or, est tracé au stylet un réseau de rinceaux ponctués de motifs
à trois poinçons.
Fragments d’un
polyptyque vénitien du Trecento : des indices pour une restitution
La radiographie a mis en évidence
que les huit saints en pied ont été peints sur une même planche découpée,
formant quatre paires ; en étudiant l’obliquité du fil du bois,
Elisabeth Ravaud, chargée des études radiologiques au C2RMF, a estimé
que les registres inférieur et supérieur étaient distants d’environ
7,5 cm.
Des traces de clous, visibles à l’œil nu ou révélées par la
radiographie, correspondent à l’emplacement des traverses au revers
des panneaux. Par comparaison avec des polyptyques non démembrés de
Paolo Veneziano, ces traces permettent d’élaborer des hypothèses de
restitution de l’ensemble.
L’hypothèse la plus
vraisemblable dispose les saints en pied en six paires verticales, pour
former le cycle des douze apôtres. Des colonnettes torsadées, dont on
repère la trace sur les panneaux, devaient les séparer de grands
saints en pied.
Au centre du polyptyque, le panneau principal devait représenter un
sujet lié à la dédicace de l’autel, de la chapelle ou de l’église,
Couronnement de la Vierge ou Vierge à l’Enfant, par exemple.
Les saints en buste, encore encadrés de colonnettes, se placeraient sur
un registre plus élevé, alternant sans doute avec des scènes
narratives en correspondance avec le panneau central.
Les saints sur fond d’or trilobé, Nicolas de Bari et Léonard,
appartenaient de toute évidence à la prédelle : peints sur des
panneaux de fil horizontal, ils étaient cloués sur le soubassement du
polyptyque, selon la pratique vénitienne. |
La restauration des panneaux de Poitiers
Les panneaux ont fait l’objet d’une campagne de restauration, en
2001-2002, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, à
Versailles.
Nettoyage, dégagement des repeints et consolidation
Avant l’intervention, l’ensemble était recouvert d’un vernis sombre.
Sur dix panneaux, les bords avaient été recouverts d’un badigeon rouge, à
l’emplacement d’éléments d’encadrement disparus. De nombreux repeints
masquaient des lacunes. Sur quatre des saints en pied, des zones triangulaires
non peintes, en partie basse, avaient été maquillées pour unifier le sol.
La restauration a permis une purification des surfaces, le dégagement des
repeints et des badigeons rouges. Les supports, en bois de peuplier, ont été
traités contre les insectes, et les fentes et les déformations entraînées
par les clous au revers, consolidées.
Les zones non peintes, simplement enduites d’une couche de préparation à
base de gesso, étaient occultées, dans le
retable, par des éléments d’encadrement. La forme triangulaire à la base de
quatre saints en pied correspond à la partie recouverte par le gâble qui
couronnait les figures du registre inférieur. Les saints en pied devaient donc
être peints par paires, sur une même planche, comme l’a confirmé la
radiographie.
|
De la Vierge à sainte Marguerite d’Antioche
La sainte en buste de la série des quatre panneaux ayant conservé leur
encadrement, était identifiée, avant restauration, comme la Vierge ; elle
était accompagnée de son monogramme, MP – ΘV
(qui se lit « Mère
de Dieu », en grec), peint en rouge de part et d’autre de son visage.
La restauration a révélé que le monogramme avait été ajouté a
posteriori et qu’un repeint masquait la croix tenue, à l’origine,
par la sainte. Il pourrait s’agir de Marguerite d’Antioche, qui triompha du
dragon en brandissant cette croix.
|
Les saints représentés
Les attributs des saints représentés permettent leur identification,
confortée par le titulus, inscrit en rouge à côté
de leurs visages, qui donne leur nom.
Un cycle fragmentaire des douze apôtres
Bien que cinq des tituli soient effacés,
l’identité des trois autres saints en pied, Paul, Philippe et Barthélemy,
permet d’établir qu’ils appartenaient à un collège apostolique. Ils sont
dotés soit d’un livre, soit d’un rouleau, symboles des Écritures. Seul
saint Paul, « prince des apôtres » avec saint Pierre, se distingue
par son attribut, l’épée.
Des saints choisis
L’identité des autres personnages était déterminée par la faveur de ces
saints dans l’église à laquelle était destiné le polyptyque, en lien avec
des cultes locaux, les patrons d’un ordre religieux ou les commanditaires.
Évêque de Myre en Asie Mineure au IVe siècle, saint Nicolas de Bari
est représenté âgé, vêtu de ses habits sacerdotaux. Son culte se popularisa
considérablement en Italie après le transfert de ses reliques à Bari, en
1087.
La Légende dorée écrite par Jacques de Voragine
au XIIIe siècle, a accru, notamment en Italie du Nord, la faveur de saint
Léonard, compagnon de saint Rémi retiré dans un ermitage limousin au
VIe siècle. Il a les traits d’un homme assez jeune. Il tient la croix et
porte une couronne, symbole de sainteté.
C’est la même source littéraire qui rendit célèbre sainte
Marguerite, vierge et martyre légendaire du IIIe siècle. Dévorée
par un dragon alors qu’elle priait, elle put sortir du ventre du monstre grâce
à une croix qu’elle tenait.
Saint François d’Assise porte la robe de bure de l’ordre
qu’il fonda. Canonisé en 1228, seulement deux ans après sa mort, il devint
rapidement le saint le plus vénéré en Italie puis dans toute l’Europe. Sa
main droite, et sans doute son côté droit, effacé par une lacune, portent les
stigmates, des plaies identiques à celles du Christ, qu’il reçut lors
d’une apparition.
Saint Fantin, mort à Thessalonique vers l’an mil, était très
en faveur en Vénétie. Il porte la palme des martyrs.
Coiffé traditionnellement d’un chapeau de cardinal, ce qu’il ne fut jamais,
saint Jérôme, docteur de l’Église, était un érudit retiré
dans un ermitage en Syrie, au IVe siècle. De retour à Rome vers 382, il
traduisit la Bible en latin, à la demande du pape, d’après la version
grecque de la Septante.
|


